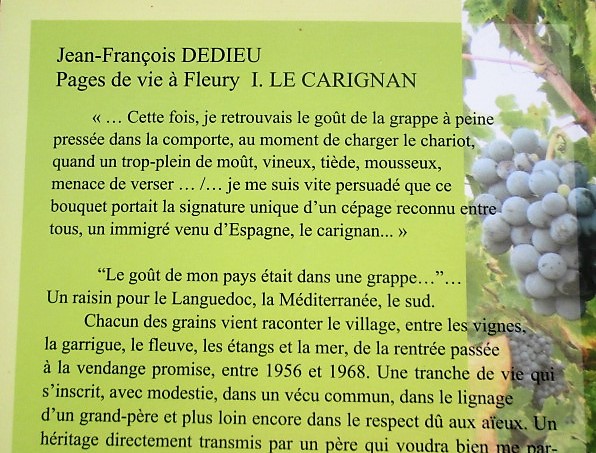Les jeunes, allez lire ailleurs, c'est pas de vos âges ! et pardon à tous les autres au nom de la vie qui continue... Hésitations : le garder pour soi ? Partager ? C'est le jour pour le dire... demain, pour les autres, on remettra le gilet pare-émotion...
Assailli par la floppée de dates rappelant malheureusement le départ pour l'autre monde de visages plus ou moins familiers, reconnus, connus, plus ou moins appréciés, dans tous les cas non sans respect, serait-ce seulement celui de la mort. Parmi eux, ceux que nous aimons un peu, beaucoup, avec un brin d'empathie sinon passionnément, jusqu'à les emporter avec nous jusqu'au bout.
Alors, on fait son possible pour retenir des dates, malheureusement éparses, de tristes anniversaires.
Plus facile à retenir alors que les pages des jours tournent si vite, déjà un mois, on se recueillait pour les cendres de Louis Marchante (25.12.1963 / 30.09.2025), 61 ans... Faut-il préciser “ seulement ” puisque de toute façon c'est toujours trop tôt ? Louis qui vient télescoper mon souvenir, remonter loin dans l'album, Louis de la rue du porche comme nous disions familièrement, Louis, petit garçon du temps des vendanges, jouant dehors, souvent sous la garde de sa sœur à peine plus grande, en amont de la menuiserie Jeannot Guiraud. Lorsque je descendais au village, lavé de frais du moût de la journée non sans penser un instant à André, le copain de classe, si heureux de partir en vacances et parti pour de bon, à neuf ans “ seulement ”. C'est mort tout ça, avec les files de charrettes et presque celles des tracteurs ronflants au quotidien. C'est à peine aujourd'hui si on entend le vacarme d'une remorque brinquebalante repartant sans rien. La faucheuse, elle, ne repart jamais à vide...
 |
| Louis Marchante (25.12.1963 / 30.09.2025), le petit garçon “ des vendanges” |
Autour de Louis, “ le petit Espagnol ” (chose que j'ai toujours dite, contrairement à certains esprits aussi tordus qu'étroits, familièrement mais avec sentiment d'abord pour un enfant et aussi par respect pour nos cousins et semblables d'outre Perthus) (1), un pied de vigne dans une jarre, hommage émouvant à Jean-Marie, 54 ans.
Dans ce troisième et nouveau cimetière, hélas, avec le vieux et l'ancien nouveau, l'endroit le plus peuplé du village, mon copain José David, qui y repose (28.06.1949 / 26.02.24) (2),
 |
| “ Jo ”de la carabine et de la pêche à Aude, José David (28.06.1949 / 26.02.24) |
le copain, mon double presque pour la carabine, le cross, la pêche au muge, l'été à Saint-Pierre, la Simca 1000, bref, une complicité forte, profonde, “ parce que c'était lui, parce que c'était moi ”... Et sur sa tombe, quelques mots échangés avec Viviane...
Avec Viviane, c'est Louis son mari, parti à 41 ans (13.12.1947 / 19.06.1989), vaillant ouvrier de Julien Sierra (lui de 1922 comme papa, (20.08.1922 / 24.03.2021), qui, en 1956, parce que j'en revenais, me chantait « Joseph est au Brésil »... Triste jour pour les Louis, lui, toujours attentif aux autres, toujours au mot gentil, qui revient souvent me sourire.
 |
| “ Mazo” du croquet et des falcinelles, Joseph Romain (7.09.1950 / 2.12.2020). |
Et puis au colombarium, s'il n'est pas ailleurs, Joseph justement, Joseph Romain (7.09.1950 / 2.12.2020, 70 ans) aussi, je cherche, “ Mazo ” de son surnom, du quartier aussi, copain de classe dans tous les sens du terme, qui sarcissait lou crouquet pour mieux tenter le poisson, qui espepissait comme il disait pour signifier qu'il allait chercher minutieusement une info dans les bouquins, qui était venu me chercher pour photographier des falcinelles au marais avant que les gardes, sur demande des patrons, ne les aient tous tués à fin d'empaillage, Mazo qui s'appliquait le « viure al pais », Mazo de nos rares rencontres bien que pleines de tout ce que nous avions en partage...
Encore un Romain de mon temps, du village, Michel (13.02.1949 / 23.02.2017, 68 ans), perdu loin à Lyon... belle ville certes, dix ans de ma vie mais trois semaines de retard pour le renouveau des platanes...
Toujours Romain, ne l'aurais-je pas connu, Arnold, de l'âge de mes grands fils (1.11.1972 / 4.12.2024, 52 ans), si dynamique, mort sans avoir vu ses filles...
Paisible, cet endroit du dernier repos. Pointant vers le ciel, dans la force de l'âge, les cyprès (130-150 ans seulement...) du vieux cimetière, protégeant de la canicule d'été, donnent déjà le frisson de Toussaint malgré la douceur des températures. Pensées pour Sylvie, Patrick (le cœur), Michel (? capitaine, promu chef d'état-major de la gendarmerie, contemporain des affaires des frégates de Taiwan ou d'Arabie Saoudite sinon des sous-marins de Karachi...), Florence, Sébastien (accident routier), Jacky 54 ans, mon cousin (accident de chasse), pour seulement l'allée principale à parcourir... sans savoir s'il faut s'attarder ou hâter le pas par pudeur pour ceux que l'instant oublie...
.jpg) |
| “ JFK ” du goyavier « ...pour la bouche gourmande des filles du monde entier. Jean-François Knecht (30.9.1957 / 28.4.2007) |




.JPG)
.JPG)