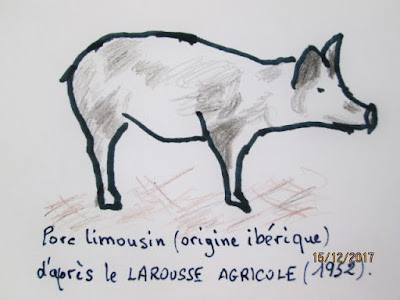Au pays de l’Albine, dans le
Périgord vert, les cochons sont noirs (1). L’Albine ? une maîtresse femme
capable de s’occuper des bêtes, de faucher, de moissonner, de tenir son
intérieur. Sourcière, presque sorcière comme l’écrit si bien son petit-fils
Fernand (2), elle soigne aussi bien les gens que les animaux. En osmose avec sa
terre, les plantes, les champignons, le gibier, elle préfère dire
« braconneuse » que braconnier. Dans sa cave, ses liqueurs, son vin,
sept eaux différentes (de rosée, d’aspic, de crapaud, de rossignol, de la
Saint-Jean, de Sainte-Catherine, électrique aussi !), cent-quarante-sept
bocaux de légumes, de fruits, de confitures, de quoi tenir un siège ! et
cinq gros pots de grès pour le lard, le salé, les cochonnailles !
Je vais le relire ce livre,
surtout que je ne me souviens pas des pages sur le cochon. Je les ai
cherchées pourtant : je présumais que dans les fêtes qui comptaient à la
campagne, entre Balthazar et Jésus, un jour lui était dévolu !
Entre les Rois et le mercredi des
Cendres, en effet, avant le Carême qui annonce Pâques, il faut en
profiter : le sacrifice du cochon est alors l’incarnation des plaisirs, de
l’abondance. Et avec carnaval, les licences permises, il vient renchérir sur le
pêché de chair…
« Il faut faire carême-prenant
avec sa femme et Pâques avec son curé… »
« Iéu
crese qu’aquest caremau
Lou
salat nous fara pas mau. » D. SAGE
«
A caremo, amo li tiéu
E
à Pasco, amo Diéu. » (3)
« …
Pour tuer le cochon, l’Albine n’avait pas son pareil. Elle officiait dans tous
les environs… »
Ce n’est pas tant de le tuer,
mais de bien le saigner, précise Fernand ; la qualité de la viande, aussi,
en dépend. L’Albine qui ne ratait jamais son coup ne manquait pas de faire ensuite
la blague du couteau. Le plus sérieusement du monde, comme chaque garçon avait
alors le sien en poche, elle s’en faisait prêter un pour le faire prestement
disparaître dans le cul du cochon… « Le bon Dieu te le
rendra ! ». Le lendemain, contrairement au charcutier, elle rendait
son bien au nigaud déconfit. Les mœurs étaient rustiques, les gens moins
délicats alors !
Dans le travail qui s’ensuit, en
montant vers Limoges, ils brûlent les poils du gagnou (cochon en limousin, vous
aviez compris) avec des poignées de paille puis raclent avec des bouts de tuile
neuve. Le cochon est attaché sur une échelle dévolue à cet usage unique puis l’experte
ouvre l’abdomen vers le bas, la poitrine. Ensuite, contrairement à Sorgeat (le
climat sans doute), la carcasse est aussitôt débitée et l’Albine s’attelle à la
confection des boudins.
Suivent quatre pages sur ce
travail. L’auteur conclut avec un dicton en occitan version limousine :
« O semble un porc, ne forô
dô bé qu’après so mor. » (Il est comme un cochon, il ne fera du bien
qu’après sa mort).
Entre les Rois et Mardi Gras,
nous reviendrons en détail sur toutes ces préparations qui devaient tenir jusqu'à la soudure, sans
possibilité de conserver par le froid et en tenant compte de l'humidité du climat atlantique chez l'Albine (à Fleury aussi, par rapport aux villages de l'intérieur, le marin, lou marinas posait problème).
(1) Cul noir périgourdin avec
seulement la tête et la croupe noires.
(2) Fernand Dupuy / L’Albine /
Librairie Arthème Fayard 1977 (Elle a 90 ans lors de l’écriture du livre).
(3) Je crois que ce carême le
salé ne nous fera pas mal / Pour carême aime les tiens et à Pâques aime Dieu. Frédéric
Mistral, Trésor du Félibrige, entrées « caremau » et « careme ».
Photo de l’Albine sous son fagot
de fougères empruntée à l’auteur Fernand Dupuy (1917-1999)… que ses mânes me pardonnent…